Retour vers table des matières
II – À la Manufacture Française de Tapis et Couvertures MFTC
J’arrivais donc à Beauvais au moment où la crise venait de s’étendre à tous les U.S.A. et gagnait progressivement le monde entier. Les premiers mois furent difficiles; GODDARD avait des habitudes de travail déplorables. En dehors de la MFTC, il s’occupait de la mise en route des premiers bureaux des ASSURANCES SOCIALES (avenue de Lowendal) qui devaient devenir, plus tard, la SECURITÉ SOCIALE.

Il devait, en même temps, avoir des intérêts chez KARDEX car toutes les organisations qu’il étudiait ou mettait en route utilisaient ce modèle de fiches et les meubles que celles-ci exigeaient. De plus, il s’intéressait aux avions COUZINET ; Celui-ci était célèbre car constructeur de l’ARC EN CIEL, premier avion à aile épaisse créé dans le monde et qui battit de nombreux records. Faute de moyens financiers, COUZINET dût abandonner mais son avion fut copié et les principes de sa conception sont toujours les bases des cellules des avions modernes.
À la MFTC, GODDARD s’était attaqué au service Entretien, véritable usine dans l’usine, et qu’il voulait organiser avec une gestion autonome. Il l’avait baptisé » Service Technique » avec, à sa tête, un ingénieur des Arts et Métiers: Mr. SERRE, pilote d’aviation de réserve. GODDARD ne semblait pas avoir de plan à long terme et ne cherchait pas à analyser le fonctionnement de la MFTC dans son ensemble: la surveillance des ateliers de fabrication ne semblait pas l’intéresser, du moins pour le moment. D’autre part il était rarement à Beauvais dans la journée: il arrivait de Paris en taxi vers I8 heures et nous commencions à travailler, puis nous dinions ensemble à l’hôtel de la Poste où j’avais une chambre. Son menu était toujours le même: un jambonneau entier et un saladier de petits oignons.
Nous passions des heures à discuter de l’installation des fiches qu’il avait préparées et quand je lui parlais de l’incidence de ses décisions sur le personnel d’encadrement, il changeait de sujet de conversation. Il avait promis à MMrs. LAINÉ et VANDIER que son travail durerait deux ans et passé avec eux un contrat de cette durée.
Il cherchait surtout à plaire à Mr. LAINÉ en lui soumettant des plans d’une usine modèle décomposée en nombreux ateliers: mécanique, menuiserie, chaudronnerie, chauffage, force motrice, maçonnerie, peinture, vitrerie… sans s’occuper ni de l’utilité d’un tel service, ni du coût de l’installation, ni de celui de fonctionnement. Quant à moi, je servais de tampon entre les chefs de service que la réorganisation inquiétait et lui qui ne les voyait que très rarement et passait au-dessus d’eux. Les contremaîtres et le personnel subalterne ne l’intéressaient pas. Alors, tout en exécutant ce qui m’était prescrit je passais l’année 1930 à analyser ce qui se présentait, à voir comment était organisé le passage des matières d’un atelier à l’autre. La laine étant hygrométrique, changeait de poids selon le degré d’humidité et la température de l’air ambiant. Je cherchais à voir comment les ateliers qui avaient leur propre comptabilité calculaient leurs coûts, comment les magasins étaient tenus.
Je voyais souvent Mr. MORLAY, le directeur de l’usine, ancien employé, qui avait un profond bon sens. Sorti du rang, il se méfiait des gens parachutés et il était arrivé à son poste ayant grandi avec la maison. Il s’opposait souvent à GODDARD, car il n’admettait pas qu’on s’occupe d’un secteur en négligeant les incidences de ses décisions sur les autres secteurs et estimait que l’entretien constituait une dépense trop lourde pour qu’on se permette de le développer.
Il me disait de profiter des possibilités d’investigation qui m’étaient données pour trouver la cause d’une anomalie plutôt troublante: « Les ateliers prétendant tous être en bénéfice, comment se faisait-il qu’en fin d’année le compte d’exploitation global était en perte ou à peine équilibré ? »
Pour y voir plus clair, je demandais au chef de comptabilité JOSSE qui arrivait en fin de carrière et à son adjoint LEVAIN de m’apprendre à tenir un Journal et un Grand-Livre afin de profiter du contrôle interne de la comptabilité à parties doubles pour suivre les mouvements de stocks et rassembler les comptabilités partielles tenues par les ateliers.
Comme je ne m’intéressais ni à l’aspect juridique ni à l’aspect fiscal de la comptabilité, JOSSE et LEVAIN m’aidèrent sans aucune réticence et bientôt j’en savais assez pour monter une comptabilité analytique s’étendant à toute l’usine.
Chez la plupart des chefs de service, du moment que je ne voulais leur enlever aucune parcelle d’autorité, je trouvais beaucoup d’aide. Comme d’autre part, ils n’avaient pas le temps de se tenir au courant des nouvelles méthodes de rémunération du personnel (payé aux pièces presque partout sauf à l’entretien), de taylorisation, d’organisation des ateliers, de contrôle comptable, notions très à la mode vers 1930 mais trop théoriques pour beaucoup, j’essayais de voir comment tout cela pouvait être appliqué à la MFTC sans trop perturber les relations entre les uns et les autres.
J’avais ainsi trouvé le moyen de me perfectionner dans la façon de me comporter avec les gens de tous niveaux et dans la connaissance de ce qu’on pouvait demander sans risquer trop d’erreurs. D’autre part GODDARD me donnait souvent l’exemple de ce qu’il ne fallait pas faire, car je sentais l’hostilité de plus en plus générale qui se manifestait autour de lui. Quand je lui en parlais il n’y attachait aucune importance, estimant qu’il avait à donner un cadre d’organisation et que ceux qui n’accepteraient pas ce cadre n’avaient qu’à s’en aller. Par exemple il avait organisé un contrôle des mouvements de fournitures par fiches sans consulter les chefs magasiniers sur les relations que l’habitude avait créées entre ateliers de fabrication et magasins, d’où des confusions entre prix à l’unité, à la douzaine, au kilo… des bons mal rédigés ou incomplets et souvent illisibles.
Et je sentais GODDARD débordé par l’organisation des services de la future Sécurité Sociale qui l’absorbait de plus en plus. Il venait de moins en moins à Beauvais. La fin de son premier contrat-approchait. MMrs. LAINÉ et VANDIER me firent venir à Paris, au siège de la Direction générale, avenue de Messine, pour me dire qu’une prime exceptionnelle égale à deux mois de salaire m’était allouée, que le contrat de Mr. GODDARD ne serait pas renouvelé car il n’avait pas rempli ses engagements, que l’hostilité contre ses méthodes était trop grande, que le marché du tapis et de la couverture était en crise dans le secteur de l’Exportation, les principaux clients, Dominions anglais, étant en cours d’industrialisation dans notre spécialité et, en conséquence, qu’il fallait se restreindre. Ils me demandèrent de rester un an de plus à Beauvais pour sauver ce que GODDARD avait fait de bon, pour supprimer ce qu’il y avait de défectueux ou de superflu et de remettre en place un contrôle qui avait pratiquement disparu, les chefs d’ateliers gardant jalousement les renseignements dont ils disposaient. Pour faire ce travail, on me donnait une augmentation notable de traitement qui serait accompagnée en fin d’année d’une prime fonction des résultats. Au point de vue hiérarchique, je serais rattaché directement à la Direction générale, c’est à dire aux trois administrateurs-délégués, principalement à MMrs LAINÉ et VANDIER.
J’avais toute liberté d’aller dans les usines, de demander ce que je désirais dans la mesure où cela n’entraînerait pas d’embauche de personnel; cependant, on me donnait pour exécuter matériellement les travaux de contrôle, un comptable venant de l’entreprise COMMUNEAU absorbée en 1930, Mr. HUREL qui resta jusqu’à sa retraite en 1966. J’avais aussi accès aux statistiques commerciales.
Le travail était passionnant; pour moi c’était une expérience très enrichissante. Non seulement je pouvais apprendre encore beaucoup de choses, mais je pouvais maintenant prendre des contacts directs et responsables avec tous les chefs de service des usines. Ceux qui m’avaient appuyé pendant mon expérience avec GODDARD et qui souhaitaient réellement une remise en ordre seraient des interlocuteurs très valables et on pourrait ensemble prendre des décisions. Ceux qui s’étaient tenus à l’écart se trouvaient néanmoins pris dans le contrôle comptable que j’avais instauré et je pouvais, le cas échéant, les contrer en prenant quelques précautions psychologiques.
J’acceptais donc, bien que GODDARD m’eût proposé de me garder avec lui à un taux plus élevé pour l’aider à organiser les Assurances Sociales, travail qui l’absorbait de plus en plus. Mais ses méthodes de travail et son horaire de vie m’exaspéraient. Je préférais la liberté du choix de mes initiatives.
 L’année 1931 vit la fermeture du marché d’Afrique du Sud qui absorbait 15 à 20 % de notre production couvertures. Etant un gros producteur de laine, il était normal que l’Afrique du Sud transforme sa matière première. Pour la MFTC c’était la fin de la période faste de développement, il fallait serrer la gestion pour tenir, d’autant plus que la crise commencée aux Etats-Unis en 1929 gagnait l’Europe.
L’année 1931 vit la fermeture du marché d’Afrique du Sud qui absorbait 15 à 20 % de notre production couvertures. Etant un gros producteur de laine, il était normal que l’Afrique du Sud transforme sa matière première. Pour la MFTC c’était la fin de la période faste de développement, il fallait serrer la gestion pour tenir, d’autant plus que la crise commencée aux Etats-Unis en 1929 gagnait l’Europe.
Il n’était plus utile de prévoir un service Technique aussi important et un encadrement lourd. Avec SERVE qui avait été quelque peu maltraité par GODDARD, on fit un contre-plan de redressement en fusionnant les ateliers d’entretien des bâtiments sous une seule autorité, mais j’exigeais que soit maintenu le service Achats récemment créé, indépendant des contremaitres lesquels, auparavant, recevaient eux-mêmes les fournisseurs. Le service Achats gérait les magasins d’approvisionnement du Service Technique. Ces magasins accusaient chaque année un déficit de plus de 300.000 frs. Dès la fin de 1931 le déficit avait pratiquement disparu : les bons de sortie simplifiés mais maintenus permirent d’éviter des abus flagrants.
Dans les autres ateliers, on aménagea les horaires en fonction des demandes du Service commercial et à la Filature, on remplaça le salaire aux pièces trop brutal par un salaire horaire avec prime du type Rowan qui fut bien accepté par l’ensemble du personnel intéressé.
Au plan du contrôle, Mr.WATTEL qui s’occupait spécialement des usines du Nord ( Roubaix, Tourcoing, Mouscron ) avait installé depuis longtemps un contrôle comptable dans les usines: une filature et trois tissages tapis. Ce contrôle comprenait, par usine, un compte d’exploitation avec entrées et sorties de matières premières et de produits fabriqués, prise en charge de dépenses directes et d’un pourcentage de frais généraux plus ou moins arbitraire mais suffisamment approximatif.
J’entrepris de faire la même chose à Beauvais, en découpant l’usine en groupes homogènes avec magasins matières intermédiaires et je m’aperçus que les résultats obtenus étaient très différents de ceux indiqués par les chefs d’atelier, En recherchant les causes de ces écarts je m’aperçus qu’un lot de fil sortant de la filature pour un poids déterminé était entré au magasin du tissage pour un poids inférieur, l’écart étant de l’ordre de 6%.
L’explication était très simple: la filature majorait les poids livrés car ses fils étaient trop secs et le tissage notait les poids réellement constatés. Cet écart était normal car, officiellement, les fils de laine doivent être évalués à un taux hygrométrique de 16%; or, dans une filature, l’air ambiant est chaud et sec pour que les opérations s’effectuent correctement. Pour les transactions avec les clients extérieurs à l’entreprise on fait conditionner les livraisons par un bureau officiel dont le laboratoire dépend de la Chambre de Commerce de Roubaix. Il n’était pas question de conditionner toutes les livraisons intérieures à l’usine, chaque conditionnement durant 24 heures. Je réunis les chefs de la filature et du tissage et on se mit d’accord sur un « conditionnement en gras » c’est à dire que l’on mesurait par sondages la longueur de fil livré et on convertissait en poids théorique. Cela permit de serrer de plus près les problèmes de consommation de matières.
Le contrôle des magasins fit apparaître des stocks dormants, des fils mal teints, des fins de lots inutilisées, bref tout un capital immobilisé qui pouvait être remis dans le circuit de production après quelques opérations de rattrapage. Tout cela permit de faire tourner plus vite l’argent investi, d’éviter les gaspillages et de mettre chaque atelier en face de ses responsabilités.
Je voyais régulièrement Mr. LAINÉ à Paris et Mr. MORLAY à Beauvais qui me donnaient des conseils et m’indiquaient où il fallait porter mes efforts, En fin d’année une prime substantielle, de l’ordre de 3 ou 4 mois de salaire, me confirmait que mon travail était dans la ligne désirée.
L’échéance de l’année supplémentaire arrivait sans que personne ne s’en occupât et j’abordais 1932 continuant mon travail de redressement et de contrôle. Sans m’en douter j’étais un des précurseurs du contrôle de gestion d’exploitation. A cette époque le contrôle budgétaire ne se pratiquait que sur le plan financier et dans les grandes entreprises. La personnalité la plus connue dans cette spécialité était alors Mr. LOEB directeur financier de l’Alsthom, ancien mineur de Paris dont le livre « Le contrôle budgétaire » faisait autorité.
L’année 1932 vit la crise s’amplifier, Après l’Afrique du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande se fermèrent pour la même raison, puis ce fut l’Angleterre qui s’équipa pour ses propres besoins et ceux de ses territoires d’outre-mer. L’usine qui avait été montée par la MFTC en Belgique à Mouscron en 1925 pour alimenter l’Angleterre et ses dominions se trouva brutalement privée de clients. Elle fut fermée ou plutôt mise à l’extrême ralenti, car on garda l’encadrement et quelques tisserands. On attaqua le marché belge jusque-là plutôt négligé car il y avait déjà une concurrence très sévère.
Dans les usines françaises l’activité se ralentit: la troisième équipe, celle de nuit avait été supprimée et la deuxième fut bientôt réservée à la filature, L’opération fut progressive et ne posa pas de problème grave. On arrêta l’embauche; les départs volontaires vers d’autres activités moins touchées que la nôtre suffirent à réduire l’activité pendant quelques mois, puis il fallut se résoudre à réduire l’horaire général, l’effectif étant passé de 3.000 à 2.000 personnes avec très peu de licenciements.
Au plan de l’organisation, le climat était plutôt favorable. On cherchait moins à améliorer la productivité du travail qu’à lutter contre les gaspillages, car la matière première représentait le poste le plus important du prix de revient.
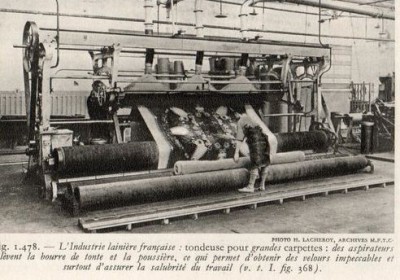
Le calcul des coûts, grâce à la division de l’entreprise en sections homogènes, permit de connaître l’importance relative de chaque poste de dépenses, et d’obtenir des adjudications en admettant un arrêt provisoire de la couverture de certains frais fixes. Cette politique fut pratiquement suivie jusqu’en 1936.
Mais en 1933 un nouveau problème tout à fait personnel se posait pour moi, Je venais de me marier… Si je restais à la MFTC, ce qui paraissait normal puisque le contrat verbal passé lors de mon entrée et renouvelé ensuite semblait se transformer en situation permanente, quel serait mon avenir ?
A Beauvais Mr. LAINÉ avait placé son fils ainé, Hubert, auprès de Mr. MORLAY dans le but de remplacer ce dernier quand il se retirerait, ce qui ne pouvait tarder en raison de son âge. A Paris Mr. VANDIER, qui vieillissait également avait pris Pierre LAINÉ comme adjoint pour toutes les questions commerciales et son propre fils Maxime pour toutes les questions financières.
Dans le Nord, Mr. WATTEL avait pris son fils Jules comme Directeur de l’usine de Roubaix (teinture et tissage) et son neveu André comme directeur de l’usine de Tourcoing (tissage). D’autre part la filature de Tourcoing était toujours dirigée par son ancien propriétaire Mr. DECONINCK qui avait pris auprès de lui un de ses fils, Philippe, l’autre étant à Centrale (ce dernier devait plus tard épouser la fille d’un industriel de Monestier de Clermont, Melle ALLIBERT, diriger et développer considérablement l’affaire de son beau-père avec l’apparition des plastiques, enfin fusionner avec SOMMER. Il est maintenant P.D.G. de SOMMER-ALLIBERT )
Enfin l’affaire COMMUNEAU, dont les usines étaient à Beauvais et Herchies spécialisées dans la fabrication des couvertures et molletons de laine, étant intégrée dans le groupe de Beauvais, Mr. COMMUNEAU avait pris la direction des achats de laine, poste très important car nous utilisions plusieurs milliers de tonnes de cette matière par an.
Bien que mon salaire croissait régulièrement, ainsi que les primes, bien que les encouragements de Mr. Lucien LAINÉ ( le grand patron ) étaient constants, j’étais cependant inquiet et, sans le formuler ouvertement, je laissais entendre que je voyais mal quel poste je pourrai occuper autre qu’un poste subalterne et que je me posais la question d’un départ éventuel.
Mr. LAINÉ me dit alors que le travail que j’avais fait commençait à porter ses fruits, qu’il était indispensable que j’en surveille l’application, car personne à la MFTC n’était en mesure de le faire et que je n’avais pas à m’inquiéter pour mon avenir. Il me dit aussi que la MFTC participait à une commission créée par un de ses amis, polytechnicien, Jean MILHAUD, qui cherchait au sein de l’organisme patronal : Confédération Générale de la Production Française (ancêtre du Conseil National du Patronat Français) à vulgariser les méthodes d’organisation et de contrôle qu’il était allé étudier sur place, aux Etats-Unis. Mr. COMMUNEAU représentait la M.F.T.C, au sein de cette commission et Mr. LAINÉ me proposa de l’accompagner en vue de le remplacer car il avait l’intention de le faire élire Président de la Chambre Syndicale des Fabricants de Couvertures et molletons de Laine. Ce qui fut fait.
C’est ainsi que j’entrais à la Commission Générale d’Organisation Scientifique, connue depuis sous le nom de CEGOS.
La crise s’amplifiant, les travaux de la CEGOS avaient un écho très important dans la plupart des industries françaises et les groupes de travail réunis épisodiquement devinrent de plus en plus fréquents et je passais une après-midi par semaine à Paris.
Ma participation aux travaux de la CEGOS était bénéfique pour la M.F.T.C. ainsi que pour la CEGOS car je disposais d’un terrain idéal pour tester les principes que nous cherchions à mettre en valeur et les solutions que nous préconisions aux problèmes du moment. Ceux-ci étaient nombreux et communs à toutes les professions.
C’est ainsi qu’au cours des années 1934 à 1936 on perfectionna à Beauvais et dans le Nord notre outil de contrôle et que les évènements de 1936 n’eurent pas pour nous les répercussions que certaines entreprises mal préparées durent subir.
D’ailleurs, sur le plan social, grâce aux idées très généreuses de Mr. Lucien LAINÉ (on disait que sur les questions sociales il était en avance de dix ans sur la mentalité patronale en général) la MFTC faisait figure de précurseur.
Avant la généralisation de la Sécurité Sociale, la MFTC avait créé une caisse d’assurance maladie qui fonctionna fort bien jusqu’à ce qu’un jeune médecin nouvellement arrivé à Beauvais utilise pour se faire une clientèle, l’attribution quasi systématique d’arrêts de travail. La Caisse ne résista pas à cette avalanche de congés maladie. Il fallut changer de système.
Pendant la crise la MFTC avait étudié une caisse de chômage pour compléter à 32 heures le temps de travail rémunéré dans le cas où l’horaire hebdomadaire réel tomberait au-dessous de cette limite. La caisse devait être alimentée par une double cotisation patronale et ouvrière quand le temps de travail excèderait 34 heures. Je ne me souviens plus si cette Caisse a vu le jour.
De même depuis I933 une Assurance-groupe fonctionnait pour l’ensemble des cadres. Elle devait procurer à 55 ans soit un capital, soit une rente viagère. Elle fonctionna jusqu’en 1946, date de mise en place du régime actuel.
Enfin vers 1934 ou 1935 il y avait en France dans certains milieux une campagne en faveur des congés payés, et certaines personnes se proposaient pour remplacer bénévolement des ouvriers ou des employés qui pouvaient partir sans que leur salaire soit diminué.
Mr. LAINÉ proposa pour essai l’usine de Beauvais qui reçut ainsi à la Teinture un ancien major de l’X.
Les évènements de 1936 et surtout les dévaluations monétaires qui en furent les conséquences entraînèrent une nette reprise d’activité. D’autre part l’atmosphère de pré-guerre qui régnait en Europe et l’augmentation des crédits militaires favorisaient l’accroissement de l’activité couvertures et molletons. En 1937 et 1938 un nouvel équilibre fut trouvé et les bénéfices réapparurent au Bilan.
En 1938 l’Anschluss réalisé par HITLER entraîna le rappel de classes militaires et je fus appelé et affecté à la réception des classes de réservistes à la gare de Beauvais. Cela dura environ huit jours et je repris mes occupations habituelles.
Mais, cette même année, la CEGOS créa à la demande du patronat un Bureau Permanent des Prix de revient. Il fallait quelqu’un pour le superviser et assurer les contacts avec les syndicats patronaux.
Les membres de la CEGOS étant trop absorbés par leurs responsabilités professionnelles, Jean MILHAUD me demanda de m’en occuper : cela nécessitait à peu près une ou deux journées par semaine. J’en parlais à Mr. LAINÉ qui m’encouragea à accepter en me demandant seulement de faire une réserve pour le cas où le travail serait plus absorbant, car il voulait que je reste à la MFTC. En fait le bureau se développa mais j’avais recruté du personnel et mes interventions ne me prirent pas beaucoup de temps.
Cela dura jusqu’à la déclaration de guerre de 1939. Mr. LAINÉ avait demandé mon affectation spéciale à la MFTC. D’autre part ma vue très déficiente de l’oeil droit (2/10 environ) m’empêchait d’utiliser les appareils optiques employés dans les transmissions.
Dès les premiers jours de la mobilisation, je rejoignis le centre d’Amiens qui me renvoya à Beauvais pour un mois. Jusqu’en mai 1940, pendant la « drôle de guerre », le scénario se renouvela tous les mois.
Le I0 mai 1940 les véritables hostilités commencèrent. Les alertes se succédèrent tous les jours. Très rapidement les nouvelles devinrent très mauvaises: invasion de la Belgique et du Nord de la France. Le Préfet donna l’ordre à tous de continuer à travailler comme si rien ne se passait. Mais il y avait deux usines où la main d’œuvre féminine était prépondérante: les Textiles artificiels (Nationale de la Viscose) et nous. Hubert LAINÉ se tenait en contact permanent avec le directeur de la Viscose qui était à Paris. Tous les soirs, je retrouvais les ingénieurs de la Viscose dans un café de la place Jeanne Hachette et on se donnait réciproquement les renseignements glanés ici ou là. Le 22 ou le 23 mai vers 17 heures, 1/4 d’heure après la sortie des ouvrières de la Viscose, l’atelier de bobinage était bombardé. Pas de victimes mais matériel hors d’usage. LAURANS, ingénieur chef de fabrication me dit : « les instructions officielles c’est très bien, mais irréaliste; je suis responsable des filières en platine et on va être obligé de fermer l’usine après le bombardement. Nous partons dans deux heures pour Albi ». Je transmis la décision à Hubert LAINÉ qui décida d’arrêter aussi et d’évacuer le lendemain soir, après avoir payé les salaires, les archives principales et la comptabilité sur Dinard où Mme LAINÉ avait une villa. La colonne de camions s’ébranla vers 23 heures avec une partie du personnel qui ne voulait pas rester à Beauvais. Dans la soirée, outre la bombe sur la Viscose il y avait eu d’autres bombardements sur la ville et la voie ferrée qui longeait l’usine.
Nous avons roulé tous feux éteints toute la nuit, heureusement sans incident, et sommes arrivés à Dinard le matin. J’ai aussitôt quitté la caravane qui s’installait sur place pour rejoindre la Rochelle et avoir des nouvelles de la famille. Je suis arrivé le jour de la naissance de mon fils Didier, le 25 mai 1940, avec la 402 de l’usine.

Le 26, un télégramme de la MFTC me dit d’attendre les instructions sur place, le 28 une lettre de Mr. LAINÉ donne des nouvelles de son fils Pierre replié à Cherbourg et de Jules Wattel fils observateur. Le lendemain un télégramme m’ordonne de rentrer à Beauvais, ce que je fais aussitôt et on remet l’usine en marche (en réalité quelques métiers car il n’y a guère que le personnel d’encadrement). La situation devenant intenable, la reprise d’activité ne dura qu’une petite semaine. H. LAINÉ décida d’arrêter, de faire la paie et de partir. Le 7 juin, pendant que LENAIN faisait la paie à proximité d’un abri, les bombardements se succédaient, on était en alerte continue. Dans la journée 42 bombes sont tombées sur l’usine (ce n’est que plus tard que l’on put compter les points d’impact). Le soir nous passons la nuit dans l’abri de l’ancienne usine COMMUNEAU et dès le lendemain matin nous conduisons nos voitures de l’autre côté du Thérain afin de ne pas être pris au piège si le pont était détruit. Vers midi nous partons à quelques voitures pour Paris et nous arrêtons à une douzaine de kilomètres de Beauvais vers Auneuil, en bordure d’un bois car nous voyions des vagues de bombardiers à basse altitude. Tous déversaient leurs bombes incendiaires sur la ville qui fut totalement détruite. Sur 2500 maisons qui constituaient le centre, à peine 50 subsistèrent ou purent être réparées. En passant à Pontoise il fallut laisser passer une colonne de militaires parmi lesquels nous retrouvons Jules Wattel fils.

Nous reprenons la route de Paris où nous retrouvons Mr. LAINÉ qui espère toujours envers et contre tout un redressement. Il me donne un ordre de mission pour rechercher, dans la région du Sud-Ouest s’il y avait des locaux où on pourrait, le cas échéant, réinstaller une fabrication de couvertures, Nous avions un concurrent en Charente qui produisait des articles de très belle qualité. Il fallait de l’eau douce sans calcaire.
Or, il y avait à l’l’Ile d’Elle près de Marans des locaux assez vastes et un canal dérivé de la Sèvre Niortaise passait à proximité. Bien que les évènements ne donnaient guère d’espoir, je me fis attribuer par la gendarmerie de la Rochelle un sauf-conduit pour retourner à Paris le 12 juin. Vers Chartres je suis arrêté par un barrage; les Allemands sont à Rambouillet mais la route d’Orléans à Paris est toujours libre. Je m’y précipite et arrive à la Porte d’Orléans en remontant une colonne de réfugiés. De la porte d’Orléans à l’avenue de Messine, personne. Je vais rue de la Bienfaisance où notre concierge est encore là: il me dit que Mr. Lucien LAINÉ, et ceux qui étaient avec lui sont partis pour le Massif Central mais que lui est décidé à rester. Comme j’étais à court d’essence, il m’indique un garage vers la rue de Courcelles où on liquide le stock (au marché noir évidemment); je refais le plein et je repars pour la Porte d’Orléans. Arrêté par des gendarmes, ils me réquisitionnent pour emmener quelques militaires ou réfugiés (je ne me souviens plus) en direction de Malesherbes, seule issue encore ouverte de Paris.
Au milieu d’une cohue indescriptible de réfugiés dans toutes sortes de véhicules ou à pied, de temps en temps bousculés par des véhicules militaires filant vers le sud et n’hésitant pas à jeter dans le fossé tout ce qui les gênait, je ne sais pas combien j’ai mis de temps pour joindre Malesherbes ni quelle distance j’ai parcourue car on était constamment détournés. Ce que je sais c’est qu’en arrivant à Malesherbes, mon levier de changement de vitesse m’est resté dans la main et que ma provision d’essence était épuisée. J’ai donc dû abandonner là les gens que j’emmenais ainsi que la voiture qui ne m’était plus d’aucune utilité. J’allais à pied jusqu’à la gare où il y avait un train militaire. Muni de ma carte de lieutenant de réserve et du sauf-conduit de la Rochelle, je suis allé trouver un colonel (colonel COSTEDOAT, je crois) lui demandant de me prendre en Charge. Il hésita puis me dit qu’au point où on en était, je pouvais venir avec son régiment à condition de m’en aller si une action venait à être engagée, car j’étais en civil.
C’est ainsi que je joignis Gien, mais le train fut bientôt attaqué par une escadrille; tous s’égaillèrent dans les champs et je me tenais dans un trou en attendant que cela cesse. On était à proximité d’une gare; j’y allais et y trouvais un employé de la SNCF. Il y avait un standard téléphonique et nous avons essayé de téléphoner, mais partout on répondait en allemand. Nous étions bien dans une poche et il était impossible d’aller plus loin par des voies normales. Nous étions très près de Briare et je résolus d’essayer de joindre cette ville en empruntant la voie ferrée. Au bout de peu de temps, peut-être avais-je fait un kilomètre avec la valise qui me restait, je suis tombé sur un soldat allemand qui me conduisit à une clairière où des civils comme moi étaient gardés par quelques soldats commandés par un officier muni d’un brassard de la Croix-Rouge. Il nous dit d’attendre qu’il revienne pour lui montrer nos papiers et partit donner des ordres à un groupe armé qui se mit en batterie en direction de la Loire dont les Français occupaient l’autre rive. Parmi les civils qui étaient dans la clairière avec moi, il y avait un journaliste américain, un ouvrier italien habitant la banlieue de Paris (naturalisé je crois) et un jeune alsacien. Nous pensions que si pour commander une batterie un officier portait l’insigne de la Croix-Rouge, il ne fallait pas croire en ce qu’il disait et que la meilleure solution était de s’éclipser pendant le branle-bas provoqué par la mise en batterie. Ce fut facile et on put gagner un petit village en bordure du bois. Une brouette abandonnée reçut nos valises et nous partîmes à pied en direction de Paris mais en évitant les grandes routes. On ne put cependant éviter de rencontrer des colonnes allemandes descendant vers le Sud et des camions vides qui remontaient. Plusieurs fois ils nous offrirent de nous charger, seul l’alsacien accepta. En passant à Montargis un ou deux jours plus tard, nous le vîmes avec d’autres civils déblayer une place, sous surveillance évidemment. Je n’ai jamais su ce qu’il était devenu. Au bout de quelques jours, ce fut Juvisy et un camion français qui nous prit tous les trois en charge et nous laissa dans la banlieue vers Asnières ou Colombes pas loin de chez l’italien qui nous emmena chez lui pour y dormir.
Le lendemain nous nous séparâmes et je rejoignis la rue de la Bienfaisance où je retrouvais le concierge que j’avais quitté quelques jours avant. Je me suis installé dans une des chambres destinées aux hôtes de passage et je me suis un peu reposé.
N’ayant aucune nouvelle de Beauvais, je résolus d’y aller, et j’empruntais un vélo qui, je crois, appartenait à Pierre Lainé. J’ignorais que l’armistice était signé et que de Gaulle avait lancé son appel; je ne savais pas quel jour on était.
Je partis donc un matin et fit les 80 kilomètres qui reliaient Beauvais avec pas mal de difficultés en raison des côtes ; je dus demander un sauf-conduit pour aller chez moi et à l’usine et je sus ainsi qu’on était le 27 juin. Notre maison était totalement démolie et incendiée; dans la cave il y avait une plaque de verre ou de cristal fondu, ainsi qu’une pile d’assiettes qui paraissaient intactes mais qui tombèrent en poussière quand je les touchais.
Je fus hébergé par un ouvrier des Textiles Artificiels Mr. Lebon à qui je donnais, pour le remercier, le droit de cultiver mon jardin et les quelques outils qui étaient dans une maisonnette au fond du jardin et qui n’avaient pas été volés.
A l’usine, l’ingénieur du Service Technique SERRE était revenu et avait remis en marche une vieille machine DUJARDIN qui ne servait plus depuis longtemps, mais qui, actionnant une dynamo, a fourni du courant à la ville en attendant que le courant normal soit rétabli. Rien ne tournait dans les ateliers de l’usine qui n’avaient pas été détruits. Je n’avais donc rien à faire à Beauvais et décidais de revenir à Paris et de là à La Rochelle, ce que je fis en cinq jours avec quelque difficulté car il fallait faire de nombreux détours lorsque les ponts étaient détruits et la circulation non rétablie. Arrivé à La Rochelle, j’appris que la famille était partie à La Touche où j’arrivais vers le 5 ou le 10 juillet. Mon périple était terminé sans casse; je m’estimais très heureux.
J’attendis les instructions qui me parvinrent vers la fin du mois sous la forme d’une lettre de la MFTC me disant de rentrer le plus vite possible, l’usine allant être remise en marche, mais de ne pas ramener ma famille, les conditions de logement étant encore trop précaires.
Dès le début de juillet, la population avait commencé à réintégrer la ville et logeait dans des conditions déplorables: garages plus ou moins rafistolés, maisonnettes au fond des jardins qui avaient échappé à l’incendie, baraques de chantiers aménagées … 0n était heureusement dans une période chaude de beau temps. Hubert LAINÉ dont la maison avait été détruite comme la nôtre, avait pu récupérer celle de sa mère qui, étant séparée de la ville par une rivière, avait échappé au sinistre.
A l’usine, il y avait une commande de la Marine Nationale Française prète à être livrée au début de mai 1940 : plusieurs dizaines de milliers de mètres de drap bleu marine en 140 de large. Normalement elle devait être considérée comme prise de guerre. Mais les Allemands ne vinrent pas assez vite. Dès que les habitants commencèrent à rentrer, la MFIC leur céda à chacun 3m50 de drap pour qu’ils puissent avoir un vêtement chaud pour l’hiver. En quelques jours le stock fondit complètement et pendant toute la guerre on ne rencontrait en ville que des gens vêtus en bleu. Quand les Allemands voulurent prendre possession du stock, il n’y avait plus rien; ils n’osèrent rien dire de peur de s’aliéner la population et l’affaire en resta là. Hubert Lainé avait pris les allemands de vitesse.
Quand je suis arrivé à Beauvais, fin juillet 1940, la situation était la suivante:
– la distribution des matières premières-était organisée par l’occupant.
– Rien n’était prévu pour le tapis qui pouvait utiliser les fils existants mais n’avait pas droit aux filés de laine nouveaux.
– Ceux-ci devaient être intégralement utilisés pour fabriquer des couvertures pour l’armée allemande et nous touchions pour cela de la laine, du coton et de la fibranne selon des proportions utilisées dans les fabriques d’outre-Rhin.
– Le marché des déchets textiles : laine, coton, fibranne, jute restait libre et nous avions le droit de nous y approvisionner pour fabriquer des couvertures civiles.
En fait, grâce à notre technique de fabrication, nettement supérieure à la technique allemande dans ce domaine, on augmenta la proportion de déchets dans les mélanges pour l’armée et ainsi libérer de la belle laine vierge qui, ajoutée à la fibranne permit de faire des couvertures chaudes pour la population civile. Les allemands ne s’en aperçurent pas pendant toute la guerre et, dans les dossiers trouvés à Amiens en 1945, il y avait un rapport vantant la qualité de nos livraisons, ce qui valut quelques ennuis à la direction de Beauvais, sans suite évidemment quand on sut ce qui avait été fait. Mais on aurait pu leur prendre un peu plus de laine et on le regretta.
La comptabilité analytique continua comme par le passé, mais on supprima tout ce qui avait un rapport avec les mélanges.
La vie reprit peu à peu. Un jour on reçut un avis nous informant que la 402 (que j’avais abandonnée à Malesherbes) était à notre disposition dans un camp de récupération de la zone libre. Avec des matériaux camouflés lors des visites allemandes, on construisit une maison pour Hubert LAINÉ, et on devait en construire une autre pour moi. La plus grande partie du personnel habitait dans les faubourgs restés intacts. On aménagea des logements dans un local désaffecté, et en attendant que tout soit prêt, les cadres dont les maisons avaient été détruites logèrent chez Mme Lucien LAINÉ dont la maison, en bordure du centre avait échappé à l’incendie; elle avait quinze chambres et cinq salles de bains.
Nos familles rentrèrent fin septembre et en octobre et purent se loger en se serrant évidemment. Malheureusement, au bout de quelques jours, la maison LAINÉ devint la Kommandantur et il fallut partir en 24 heures en laissant le mobilier en place. On émigra dans la maison COMMUNEAU, également très grande quoique moins confortable ; on y vécut quelques mois puis les travaux de reconstruction avancèrent et on put trouver de la place. Une partie du mobilier LAINÉ avait pu être mise à l’abri sans que les Allemands s’en aperçussent.
Mon cas était particulier car il s’avérait qu’une seule maison serait construite car il n’y avait pas assez de matériaux pour deux et il était exclu d’en demander aux Allemands, mais je devais aller plus souvent à Paris pour la CEGOS que j’avais prise en charge (voir III CEGOS) et je n’avais plus grand chose à faire à Beauvais. Le contrôle de gestion fonctionnait bien; il n’était pas question d’affiner le calcul des prix de revient en régime de prix dirigés et j’avais plus à faire à Paris qu’à Beauvais, Je devais m’occuper de la CEGOS à la demande de BICHELONNE ( voir III CEGOS).
Nous pouvions donc nous installer à Paris et quand elle sût cela Marguerite GUILLEMET nous offrit son appartement de la rue de la Pompe et quand son bail fut expiré, nous prîmes sa suite.
En fait mon travail à la MFTC consistait à faire supporter par la Couverture l’encadrement du Tapis, à faire accepter par le contrôle des prix qui avait été mis en place que notre stock allait être vendu pour payer les frais qui restaient à la charge du Tapis, à surveiller l’écoulement de ce stock, à rechercher un marché pour des tapis en fibranne. Sur le plan financier, on fit avec Mr. LAINÉ un pari: nos réserves au bilan représentaient environ cinq fois le dividende statutaire. Si la guerre ne durait pas plus de cinq ans (c’était là le pari) il suffisait d’avoir un résultat d’exploitation nul et de distribuer aux actionnaires les réserves. Ce résultat nul était relativement facile à obtenir en ouvrant ou fermant l’écoulement du stock Tapis et il me paraissait utile d’avoir un résultat nul pour ne pas avoir d’ennuis à la fin des hostilités. Croyant à la victoire finale des Alliés, les entreprises ayant travaillé pour les Allemands seraient sûrement inquiétées et leurs profits considérés comme illicites. Il ne fallait donc pas qu’ils apparaissent au bilan. Quant à la distribution de réserves, elle était parfaitement licite et les actionnaires ne seraient pas lésés, Si la guerre avait duré plus de cinq ans, on aurait dû supprimer les versements aux actionnaires,
Tout se passa comme prévu.
Fin 1944, le CII (voir III) dont je faisais partie fut dissous et le problème de la CEGOS put être réglé facilement. J’étais donc à nouveau libre.
Il fallait envisager l’avenir de la MFTC, or:
-L’usine de Beauvais était détruite à 40 % environ
-Les usines du Nord avaient peu de dégâts
-Les stocks de produits finis étaient presque nuls
-Les stocks de matières et d’en cours étaient très réduits.
-L’approvisionnement en matières était règlementé
-Les prix de vente étaient soumis à autorisation.
-Les trois Directeurs généraux vieillissaient et il fallait prévoir leur succession.
Enfin, il y avait un problème de personnel « employé » difficile à résoudre, car, pendant la guerre, les problèmes commerciaux et comptables avaient été à peu près inexistants et de nombreux employés avaient cherché ailleurs des postes plus intéressants.
Notre chef de contentieux, BLERIOT, ne pouvait s’occuper de l’établissement des dossiers de reconstruction des usines. J’en fus chargé en liaison avec un expert du Comité Central de la Laine, Mr. CAUDRON, pour le matériel. Pour les bâtiments, nous avions un expert et j’assurais la liaison avec le Ministère de la Reconstruction.
Ce fut un très gros travail qui dura plusieurs années, mais l’usine put reprendre rapidement une activité presque normale car les bâtiments totalement détruits étaient ceux de la fabrication Tapis et de la direction de l’usine. La Filature et la fabrication Couvertures étaient presqu’intactes. La Teinture était détruite mais on put faire rapidement un bâtiment pour abriter les nouvelles barques en acier inoxydable moins nombreuses que les anciennes barques en bois.
Je fus également chargé de l’établissement des dossiers d’homologation des prix de vente et de leur discussion avec la Direction des Prix. J’avais déjà, étant au CII pendant la guerre, eu la charge d’aider plusieurs syndicats à établir de tels dossiers. Il était normal que je me charge de ceux de l’Union des Fabricants de Tapis et du Syndicat des Fabricants de Couvertures. Je fis celui du Tapis avec Mr. DROUIN directeur de la maison LORTHIOIS et père de Pierre DROUIN rédacteur au Monde.
Mr. VANDIER étant décédé peu après la fin de la guerre, Mr. LAINÉ voulut faire une réorganisation en vue du remplacement futur de la direction générale.
Il créa un Conseil du Plan qui comprenait;
MMrs Lucien LAINÉ
Hubert LAINÉ
Pierre LAINÉ
Jules WATTELL père
Jules WATTEL fils
André WATTEL
Mr COMMUNEAU
Maxime VANDIER
et moi-même
J’en assurais le fonctionnement.
En fait le nom était impropre. Il s’agissait, en réalité, d’un Comité de direction.
Les attributions étaient précises:
– Mr. L LAINÉ était le Président-directeur général.
– Mr. J.WATTEL était Directeur général adjoint mais ne s’occupait que du groupe d’usines du Nord assisté de son fils pour Roubaix et de son neveu André pour Tourcoing
– Mr. P. LAINE était le Directeur commercial.-
MMrs. – MMrs. H.LAINÉ et COMMUNEAU se partageaient la direction du groupe de Beauvais: Mr. COMMUNEAU s’occupant des achats de matières premières et de la fabrication des couvertures; Mr. H. LAINE s’occupant de la Teinture, du Tapis et des questions sociales de l’ensemble du groupe.
-Mr. M.VANDIER était le directeur financier.
– Quant à moi, j’avais le contrôle de gestion, le contrôle de la comptabilité et je devais introduire un budget d’exploitation et l’intégrer dans le contrôle de gestion, assurer le calcul des prix de revient et les statistiques commerciales. En outre j’étais chargé de toutes les questions de reconstruction.
Ayant à assurer le fonctionnement du Conseil, je devais préparer l’ordre du jour et notamment faire un rapport sur les particularités que faisait apparaitre le contrôle de gestion.
Le conseil d’administration était composé des fondateurs et de parents ou amis de ceux-ci. Parmi eux il y avait Mr. RASSON, ancien président de la Chambre de Commerce de Roubaix et P.D.G. d’une des plus grosses affaires lainières du Nord : MATHON DUBRULLE.
La reconstruction fut terminée vers 1952.
Le problème administratif de recrutement d’employés avait été réglé par une certaine embauche et par l’achat d’une batterie de machines à cartes perforées BULL.
Notre principal souci était d’ordre commercial. Nous avions espéré que le développement de la construction après les destructions de la guerre entraînerait une importante consommation de tapis. En fait nos articles étaient trop chers et on ne pouvait en diminuer le prix qu’au détriment de l’aspect et de la qualité. Ce fut un autre article qui fut adopté par le marché, un revêtement de sol dérivé du feutre, fabrication qui nous était étrangère et qui était l’apanage de SOMMER. Dès le début de la reconstruction on vit apparaitre le Tapisom à un prix à peine moitié de nos plus basses qualités; Certes le Tapisom n’était présenté que pour les logements les moins chers mais ceux—ci étaient les plus nombreux. Le développement du marché intérieur ne compensait pas la chute de l’exportation. En 1944, on avait fait un accord avec la maison LORTHIOIS et créé avec elle la marque FRANCE-TAPIS afin de réduire nos frais commerciaux et d’être plus efficace à l’exportation. Le résultat n’avait pas été merveilleux. LORTHIOIS suivait mal la cadence et il y avait des frictions alors que nous n’avions d’après nos accords aucune action sur ses usines. Il aurait fallu adopter dès le début de nos accords une position inverse; les différentes fusions qui se sont faites depuis ont rassemblé les usines de fabrication et laissé indépendants les réseaux commerciaux.
Notre cabinet de dessin avait été orienté vers des créations modernes sous la pression des LAINÉ, ces articles étaient très appréciés des connaisseurs qui aimaient le mobilier du genre scandinave et avaient un certain succès dans les expositions, mais la vente en était très limitée, nos clients ne s’y intéressant pas, et comme il y avait en France excédent des moyens de production, nous devions nous incliner. Les consommateurs de tapis qui ne voulaient pas se contenter d’ersatz comme le revêtement feutre, achetaient de la moquette classique en laine et des copies de tapis d’Orient et, dans cette dernière catégorie nous avions perdu la première place au profit d’un concurrent du Nord, la SIFT.
Nous avons profité de la reconstruction de l’usine de Beauvais pour redresser la situation en montant une batterie de métiers AXMINSTER qui pouvaient tisser des tapis en 16 couleurs sans consommer autant de laine que les métiers Jacquard. On acquit aussi des métiers double pièce comme en possédaient nos concurrents, mais il fallut refaire de nouveaux dessins, les colorations, et cet effort demanda environ I0 ans et ne commença à porter ses fruits que vers 1955.
Notre contrôle de gestion permettant de suivre l’évolution de très près, était indispensable pour convaincre la direction commerciale.
Quand la reconstruction fut terminée fin 1951, Mr. LAINÉ voulut aborder le problème de la succession de l’équipe dirigeante et cela provoqua beaucoup de remous. Tous les membres du Conseil du Plan, sauf moi, étaient des membres des familles des fondateurs. Il fallait faire un choix. Afin de ne froisser personne, Mr. LAINÉ demanda au Conseil d’Administration de désigner un de ses membres pour voir individuellement chaque membre du Conseil du Plan et il voulut que tous subissent un examen psychotechnique et une analyse graphologique.
Monsieur RASSON fut désigné par le Conseil. Il fit son enquête, fit réaliser les examens et nous reçut tous sauf les plus âgés qui devaient se retirer-dans un proche avenir. Mr. RASSON proposa au Conseil Pierre LAINÉ comme Directeur général, chargé spécialement des problèmes commerciaux (partie la plus importante) et moi comme Directeur général chargé de tout le reste. Maxime VANDIER fit remarquer que la législation en vigueur exigeait que le Directeur général soit aussi Président, mais qu’il pouvait y avoir plusieurs directeurs généraux adjoints. Pour la clientèle et pour nos fournisseurs, il fallait que le Président soit un LAINÉ. Finalement le Conseil d’Administration décida que l’on continuerait comme auparavant à avoir MMrs. Lucien LAINÉ et JULES WATTEL comme P.D.G. et D.G.A., mais qu’à leur départ Pierre LAINÉ remplacerait son père et moi Mr. WATTEL.
Evidemment cela provoqua des jalousies , des colères rentrées… Ma position était parfois inconfortable mais, avec le temps elle s’améliora. Quand Mr. LAINÉ se retira, Mr. WATTEL en fit autant et la nouvelle organisation se mit en place. Mr. Bernard DECONINCK frère de Mme H. LAINÉ et P.D.G. d’ALLIBERT entra au Conseil d’administration.
Jules WATTEL FILS disparut à son tour, et je mis les usines du Nord sous une même direction, celle d’André WATTEL qui se trouva ainsi promu. Mais le problème fondamental de l’effritement du marché du tapis se posait toujours. Cela n’était pas spécial à notre entreprise, toutes les autres souffraient; les plus faibles disparaissaient mais comme presque toutes étaient de petites affaires de famille et que les propriétaires disposaient d’autres sources de revenus, elles continuaient à tourner. Il en était de même en couvertures où la capacité de production excédait de beaucoup les besoins du marché intérieur. Or l’exportation était presque nulle, la plupart des pays du monde survenant à leurs propres besoins.
Le problème s’étendait à toute l’industrie textile; l’industrie cotonnière avait été la première touchée, mais la laine suivit. Les entreprises se repliaient sur elles-mêmes ou se regroupaient si elles le pouvaient.
En 1954 on parla beaucoup d’un procédé révolutionnaire de fabrication de moquette aux Etats-Unis: le TUFT. Il s’agissait d’une moquette bouclée en coton d’abord, en laine ensuite dont le prix de vente était très inférieur à celui de la moquette classique. Pierre LAINÉ alla aux U.S.A. et revint enthousiasmé. Il me demanda d’y aller à mon tour et d’y emmener un ouvrier tisserand que l’on avait l’intention de nommer contremaître du nouvel atelier si on le créait. Après un stage de cinq semaines, je revins avec tous les éléments pour lancer la nouvelle fabrication mais mes contacts avec les directeurs des usines visitées et avec le « chartered accountant » de BIGELOW m’avaient beaucoup inquiété: certes on ne pouvait ignorer cette nouvelle fabrication mais la distribution en était très différente de la distribution en France où la production excédant les besoins du pays, nous étions tributaires de nos clients pour nos fabrications classiques et ceux-ci voyaient rouge quand on leur parlait du TUFT. Le barrage était général. C’est que le prix de vente du tapis TUFT était bien moins élevé que celui du tapis classique, la marge entre ce prix et le prix de revient ne laissait plus une rémunération suffisante pour couvrir les frais de structure d’une maison produisant et vendant du tapis classique. J’avais fait le calcul que pour maintenir la structure d’une maison vendant du tapis classique, il fallait vendre cinq fois plus de moquette TUFT que de moquette ordinaire.
D’autre part, alors qu’un métier classique produisait de 3 à 4 m2 à l’heure, les nouvelles machines en produisaient plus de 200; la concurrence s’annonçait très sévère et fatale pour les maisons de notre catégorie. Le problème était le même pour nos clients que pour nous.
Deux solutions seulement me paraissaient possibles:
– créer une nouvelle société totalement indépendante de la MFTC et la gérer comme l’étaient les entreprises du Sud des U.S.A. avec un service commercial séparé, et laisser la MFTC diminuer ou se reconvertir. C’est ce qu’avaient fait des américains ayant leurs installations classiques dans le Connecticut et s’installant en Géorgie pour faire du tuft; ils pensaient fermer progressivement leur entreprise du Nord; mais ce qui était possible aux USA où 3.000 km séparaient les deux centres paraissait impossible en France. Le secret n’aurait pas pu être gardé.
– opérer très progressivement en installant une chaine de fabrication tournant au ralenti et servant à former du personnel, la production étant écoulée sur un marché où n’opéraient pas nos clients, la carrosserie automobile par exemple. On profiterait des marges laissées par le tapis classique pour financer et amortir le matériel nouveau, mais il fallait plusieurs années pour mener à bien l’opération.
Parallèlement on s’attaqua sur le plan commercial à diversifier nos fabrications.
Déjà en 1947, nous avions créé à Saint Martin de Ré un atelier de tapis point noué qui donnait toute satisfaction quant aux résultats.
Il y avait à Haguenau une entreprise qui fabriquait du tapis bouclé en poil de vache ou de chèvre dont le prix était bas, Le propriétaire était âgé et il voulait vendre son matériel car ses bâtiments intéressaient Boussac qui lui en offrait un bon prix. On acheta le matériel qu’il fallut enlever très vite. Le marché de ce genre d’article était petit mais assez rémunérateur car il n’y avait que deux fabricants en France et on pouvait exporter en Allemagne.
On rechercha aussi d’autres procédés de fabrication différents du tapis feutre dont le marché était saturé par SOMMER, et on s’intéressa à un procédé suisse de flockage mais l’inventeur ne put mettre son procédé au point industriellement. On dût abandonner.
On décida de faire du service après-vente, ce qui commençait à être à la mode, et P. LAINÉ, à son retour des USA, créa une filiale pour la vente-de kits pour nettoyer les tapis : une boite « SERVICE MASTER » contenant quelques flacons et boîtes permettant d’enlever les différentes taches susceptibles d’apparaître sur un tapis en usage et de rénover les couleurs. Cette filiale rapporta de bons résultats mais son chiffre d’affaires resta faible,
La diversification des revêtements de sol ne donnant pas de résultat valable, je pensais à une reconversion partielle de l’usine de Beauvais dans la fabrication de mousse de latex pour lutter contre le bruit, On mit au point une mousse à cellules ouvertes destinée à être appliquée sur des murs existants, Les essais au laboratoire de Meudon furent très favorables. On fit un essai dans un appartement parisien (à l’angle de la rue de Seine et de la rue de Buci) et l’occupant fut si satisfait qu’il nous demanda d’équiper l’appartement entier. De même on équipa une clinique pour rééduquer les sourds et on obtint la réduction des bruits extérieurs à 2 décibels. Mais, si les résultats étaient bons, le coût de l’article était assez élevé: il fallait un support pour recevoir la mousse et permettre de la manipuler, et il fallait, après la pose, placer sur la mousse un matériau assez rigide pour accrocher des tableaux ou autres objets. Notre procédé ne pouvait s’adresser qu’à un marché très réduit: par exemple isoler un central dactylographique ou mécanographique dans un immeuble de bureaux, mais on ne pouvait pas penser équiper des HLM comme nous l’avions espéré. On fit néanmoins une petite production et on put équilibrer l’exploitation avec un petit bénéfice. Mais il n’était plus question de reconversion.
Alors on pensa, voyant croître la concurrence dans le monde entier, à se concentrer pour réduire les frais généraux, Un poste d’administrateur était vacant à la suite d’une démission; Maxime VANDIEB connaissait plusieurs cadres supérieurs de la Banque de Paris et des Pays-Bas; on offrit le poste vacant à PARIBAS qui accepta et nous proposa peu après une entente avec SAINT-FRÈRES, très importante affaire textile spécialisée dans le jute: filés, tissus, toile d’emballage, sacs, cordages,…S.F. avait aussi un brevet de métier à tisser circulaire vendu dans le monde entier. Enfin, S.F. était un concurrent car il produisait du tapis bouclé. Mais le jute étant fortement concurrencé par les plastiques, S.F. cherchait à se transformer en holding, En 1930 S.F, avait créé.la CENPA, première fabrique de papier Kraft pour emballage, mais après la guerre de 1940, l’Inde et le Pakistan, gros producteurs de jute s’étaient équipés pour produire des filés, des bâches, des sacs…et le marché du jute s’effondrait. S.P. vendit la CENPA à la ROCHETTE et créa avec d’autres jutiers une filiale d’emballages plastiques : sacs, poches en polyéthylène…la-CITEP, contrôlée par S.F. à 50 %; puis avec les capitaux restante prit la majorité dans PRENATAL et dans quelques autres affaires. PARIBAS nous dit que nous ne risquions pas de perdre le contrôle de la MFTC en nous associant avec S.F. car cette entreprise avait peu de cadres et les membres de la famille SAINT, ayant d’autres occupations se contentaient de siéger au conseil d’administration.
 La proposition était la suivante: la MFTC achetait à S.F. son rayon tapis: usine, service commercial et clientèle en échange d’actions MFTC grâce à une augmentation de capital.
La proposition était la suivante: la MFTC achetait à S.F. son rayon tapis: usine, service commercial et clientèle en échange d’actions MFTC grâce à une augmentation de capital.
On se fit des visites réciproques: tous les spécialistes tapis de la MFTC allèrent à l’usine de Leers et revinrent partisans de l’opération. Il fallait déterminer le montant d’actions à émettre. Le directeur de S.F., ancien polytechnicien, GOURDON et moi furent chargés de ce travail. Après de longues discussions, on se mit d’accord sur un montant de 10 %.
Les formalités remplies, le contrat signé et adopté par les deux conseils d’administration, au cours d’un déjeuner organisé par Mr. Roger SAINT pour que nous fassions plus ample connaissance avec les dirigeants de S.F., Mr. SAINT nous dit que , si depuis plusieurs années les cours de l’action MFTC s’étaient maintenus à un niveau favorable malgré des résultats relativement médiocres (progression des dividendes très faible) c’est que la maison S.F. avait acquis plusieurs milliers de titres, en vue d’arriver à une participation de 20 % afin que la MFTC ait position de filiale de S.F. . Sur le champ, nous avons eu l’impression d’avoir été trompés par Paribas, puis nous avons pensé que si, comme il l’affirmait, S.F. se contentait de 20 %, il n’avait pas la minorité de blocage donc ne pouvait pas nous gêner; il faudrait seulement lui donner deux sièges d’administrateurs au lieu d’un.
Un autre problème nous préoccupait pendant cette période: nos rapports avec LORTHIOIS (LLF) au sein de France-Tapis. Nos accords qui dataient de 1944 prévoyaient une participation de 1/3 LLF et 2/3 MFTC (au début il y avait eu un troisième partenaire, FLIPO, qui s’était assez vite retiré et la répartition de sa part avait amené les parts respectives de MFTC et LLF à 66,25 et 33,75 %). Si la répartition des marges ne posait aucun problème, la répartition des ordres de fabrication entre les deux firmes en posait. LLF produisait les moquettes unies en grande largeur ( 4 et 6 yards ) qui alimentaient le marché américain, mais cela ne suffisait pas et il fallait aussi lui attribuer une certaine part de petites largeurs et de tapis genre orient. Or, l’attaque du TUFT aux USA rendait irrégulières les commandes américaines. Dans l’une et l’autre firme, il était impossible d’exploiter rationnellement les petites largeurs car il fallait garder des métiers dans l’hypothèse d’un rééquilibrage des productions. Pour sortir de l’impasse où nous étions, il n’y avait qu’une solution: la fusion des usines de fabri cation, ce qui aurait dû être prévu au départ; nous étions tous d’accord mais il fallait évaluer la part LLF dans France-Tapis pour le calcul de l’apport que nous devions rémunérer en actions.
Après de nombreuses discussions, des consultations auprès d’experts juridiques qui ne purent nous donner de valeur car notre cas était unique, on finit par se mettre d’accord et la MFTC absorba le rayon Tapis de LLF, laissant à cette firme son rayon ameublement. Mr. LORTHIOIS était décédé (sa mort avait déclenché l’étude de fusion) son fils aîné Robert devenait administrateur de la MFTC et son second fils Michel gardait la direction de l’usine des grandes largeurs.
Cette opération de fusion fut beaucoup plus coûteuse que l’absorption du rayon Tapis de Saint-Frères. Il fallut faire des décotes sur les stocks de LLF et cela nous empêcha de distribuer un dividende cette année-là, la première fois depuis 30 ans.
L’absorption de L’usine de tapis de S.F. se fit sans difficultés graves et les rapports avec la direction de SF ne posèrent aucun problème. Seulement, au Conseil, Mr. Roger SAINT et le représentant de Paribas s’étonnaient de notre prudence en ce qui concernait le développement du TUFT. Nous ne voulions pas nous endetter et charger le prix de revient de charges financières trop lourdes. Je défendais fermement cette position car je considérais l’autre politique suicidaire.
Le 30 ou 31 décembre 1967 Pierre LAINÉ, à titre de P.D.G. reçut la visite de Roger SAINT accompagné par son complice de Paribas venus lui annoncer que S.F. allait, dès le 1er janvier 1968, lancer une offre publique d’achat (OPA) en Bourse des titres MFTC au prix de 110 francs l’action de 50 cotée à l’époque aux environs de 80. A la question « Qu’en pensez-vous ? » Pierre Lainé répondit « Ce que peut penser quelqu’un qui rencontre au coin d’un, bois un individu lui demandant la bourse ou la vie ». L’entretien tourna court et le lendemain l’opération était lancée, valable jusqu’au 31 janvier (ou le 15 février je ne me souviens pas). Nous fîmes le compte des actions qui étaient encore entre les mains des familles des fondateurs, celles qui appartenaient au personnel de la Société et aux clients que nous connaissions, bref celles sur lesquelles nous pouvions compter pour faire capoter l’opération, mais nous n’arrivions qu’à 25 % du capital; il n’était donc pas possible d’empêcher le succès de l’OPA. Aussi, dès que SF eût acheté 83 % des actions, avons-nous conseillé à tous de vendre, ce qui fait que SF se trouva avec 83 % des actions au lieu des 51 % prévus. Comme les titres étaient très éparpillés, la possibilité de ramener les achats à 51% qui avait été inscrite dans l’offre et garantie par Paribas aurait entraîné des frais considérables pour la banque, aussi celle-ci chercha un partenaire et trouva DALAMI du groupe ETERNIT qui accepta de prendre 20 % des titres. Les nouveaux actionnaires de la MFTC étaient donc Saint-Frères pour 63%, Dalami pour 20 et Divers pour 17 %.
Dès la première réunion du Conseil d’Administration, avant l’Assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 1967, Mr. Roger SAINT demanda à tous les administrateurs sauf Pierre Lainé de démissionner de leur mandat.
En ce qui me concernait, j’acceptais volontiers car mes interventions au cours des précédents conseils n’étaient pas dans le sens souhaité par Mr. SAINT et, en cas de licenciement, étant Directeur Général Adjoint et Administrateur, j’étais révocable « ad nutum » c’est à dire sans indemnité. En échange de ma démission, je demandais seulement de conserver mon titre de Contrôleur de gestion, ce qui me fut accordé. Il faut dire que, dès l’arrivée de Roger SAINT au Conseil, il avait demandé que le mode de calcul de la rémunération de Pierre LAINÉ et de la mienne soit modifié. Jusque-là nous avions un fixe très faible et un pourcentage relativement important sur le bénéfice brut avant amortissements. A son arrivée Mr. SAINT critiqua ce mode de calcul très ancien et, se basant sur les trois derniers exercices, proposa un fixe important et une prime faible. Ma démission d’administrateur ne modifia en rien mes appointements ni mon rôle dans la société.
L’Assemblée Générale entérina la composition du nouveau Conseil, toujours présidé par Pierre LAINÉ, mais qui ne comprenait plus que des représentants de Saint-Frères, Dalami et Paribas. De plus Roger SAINT faisait entrer son filleul LEM0NNIER comme Directeur commercial adjoint de Pierre LAINÉ et DALAMI faisait entrer son ancien directeur de succursale d’Afrique du Nord, Mr. PAUL, ingénieur que je pris avec moi pour prendre ma succession, la date de mon départ à la retraite approchant (milieu de 1970).
Au moment où se produisit l’OPA de SF, nous avions entrepris, le Président et moi une tentative de regroupement avec deux de nos concurrents: la SIFT, filiale tapis du groupe TIBERGHIEN et BRICQ, fabrique charentaise de couvertures et de courroies de laine. Ces deux entreprises étaient de fausses sociétés anonymes et souffraient d’un manque de trésorerie. Comme nous étions cotés en Bourse, et que ces entreprises étaient très estimées sur le marché lainier, un rapprochement aurait pu faire de la MFTC, ou de la société nouvelle qui aurait été constituée, une des plus grandes entreprises européennes dans sa catégorie. Les pourparlers étaient assez avancés et nous avions visité nos différentes installations, comparé nos investissements et nos coûts de production. L’OPA arrêta net les pourparlers, car si ces entreprises acceptaient de faire une entente avec nous, elles ne voulaient à aucun prix tomber sous la coupe de SF. La SIFT s’orienta vers un groupe textile important installé dans le Nord et en Alsace, DOLFUSS-MIEG. Quant à BRICQ, il attendit et, lorsque les WILLOT acquirent Saint-Frères en 1969, il récupéra la plupart de nos clients qui ne voulaient pas travailler avec les WILLOT, et je pense que le développement de ses fabrications redressa la situation.
Au début de 1969, lorsque les comptes-de 1968 furent arrêtés, j’ai eu avec LEMONNIER une entrevue assez orageuse car il voulait reprendre les idées de son parrain et accélérer les fabrications TUFT, augmenter les stocks, bref investir à toute vitesse quitte à placer la MFTC très débitrice en banque. Puis il me dit que les WILLOT étaient en pourparlers avec SAINT-FRERES. Alors je compris que tout ce qui s’était passé depuis quelques années entre Saint-Frères, Paribas et nous, avait dans l’esprit des premiers, un seul but: faciliter la vente de l’entreprise Saint-Frères en la renforçant par la MFTC qui avait auprès des banques la réputation d’une entreprise solide mais qui tirait mal parti de ses possibilités. Les dix années qui ont suivi ont montré que les banques s’étaient grossièrement trompées, car gérée avec plus d’audace, par les frères WILLOT, elle a non seulement perdu toutes les réserves que nous avions constituées, vendu le domaine immobilier, et, malgré des opérations de redressement purement financières, est devenue une des plus mauvaises exploitations du groupe.
Mais revenons à la conversation que j’avais avec LEMONNIER. Voyant où il voulait en venir, je lui dis : « Vous voulez que je parte, du moins Mr. SAINT, mais je n’ai pas l’intention de démissionner. Que Mr. SAINT me licencie ». Il voulut alors que ce départ apparaisse comme motivé par une raison de santé et non comme un licenciement auprès du personnel, mais j’ai pu bénéficier de l’exemption fiscale de l’indemnité.
Je dois reconnaître que la raison de santé était pour quelque chose dans ma décision rapide d’abandonner la lutte: j’avais eu en aout 1968 pendant les congés des vertiges qui m’avaient conduit à retarder ma rentrée, et depuis j’avais fréquemment des petites hémorragies dont les médecins n’arrivaient pas à trouver l’origine. Je craignais une attaque que l’ambiance régnant à la MFTC aurait pu provoquer.
C’est ainsi que s’est terminée ma carrière à la MFTC en mai 1969, après presque 40 ans de fonctions diverses allant d’ingénieur débutant à Directeur général adjoint.
À la MFTC, après mon départ, les évènements se sont précipités. J’étais parti au début de mai 1969. On apprit aussitôt la vente de S.F. aux frères WILLOT, le retrait de DALAMI qui avait, lors de l’achat des 20 % de titres MFTC, introduit une clause leur permettant de se retirer dans le délai de deux ans si les évènements le motivaient. Lors de l’Assemblée générale de 1969, Pierre Lainé et tous les autres membres de l’équipe dirigeante sauf André Wattel furent licenciés et LEMONN1ER prit le poste de directeur général adjoint, la présidence étant réservée à un des W1LLOT(Antoine). L’exercice 1969 fut catastrophique: la perte était supérieure au capital social et LEMONNIER fut à son tour licencié. Notre Siège commercial était installé dans l’ancien Hôtel particulier de la famille de BROGLIE 16 avenue de Messine, dont nous avions conservé toute la décoration, les salons devenus salles d’exposition, le grand escalier, nous contentant de remplacer les dépendances écuries et réserves par un grand immeuble de Bureaux rue de la Bienfaisance. L’immeuble figurait au bilan pour 25.000 francs environ. Il fut vendu à la Garantie Foncière 12 millions de francs d’où un bénéfice qui permit d’éponger une perte d’exploitation. A signaler que, dans sa publicité, la Garantie Foncière a annoncé l’achat pour 13 millions. Qu’est devenu le million de francs d’écart? J’ai posé la question aux frères W. à l’A.G. de 1970 mais n’ai pu obtenir de réponse.
La situation continua à se dégrader et au début de 1979 la MFTC devint « Division Tapis et Couvertures » de BOUSSAC-SAINT FRÈRES et il est maintenant question de la fermer purement et simplement.
En suivant le cours des évènements sur le plan national et même mondial, je crois que nous n’aurions pas pu développer la MFTC car le marché du Tapis et de la Couverture est une vraie peau de chagrin, ces fabrications étant peu compliquées et à la portée des pays en voie de développement; mais si notre politique avait été suivie on aurait pu trouver un nouvel équilibre: le Tuft remplaçant la moquette classique, le tapis genre Orient de belle qualité et les annexes que nous avions créées et que les WILLOT ont supprimé: Tapis point noué à dessins modernes de Beauvais, Tapis Point de Lys (brodé) de Roubaix, Tapis point noué de Saint-Martin de Ré, mousse de latex pour isolation phonique et KIT pour entretien des tapis, tout cela aurait permis à une entreprise de 5 ou 600 personnes de survivre et de faire des bénéfices.
ANNEXE – RELATIONS SOCIALES
Au cours des pages précédentes, je n’ai pas parlé de ces relations car, étant directement rattaché à la Direction générale, je n’avais aucune initiative à prendre en ce domaine qui était réservé aux directions d’usines. Quand j’ai proposé la prime Rowan pour la Filature, je l’ai proposé à la direction de l’usine. Je ne suis intervenu qu’indirectement lors de la création des Comités d’entreprise en 1946(?). Il y avait eu, auparavant, des comités d’établissement mais je ne rencontrais les membres de ces comités qu’à titre individuel et pas pour discuter de problèmes sociaux. Mr. Hubert LAINÉ Directeur des usines du Beauvaisis (Beauvais et Herchies) avec Mr. COMMUNEAU avait engagé un chef de personnel, René GALIPPE (fils de l’ancien chef d’atelier d’entretien des bâtiments) qui savait parfaitement clarifier les problèmes qu’Hubert LAINÉ résolvait toujours avec justice et compréhension. La confiance régnait et les évènements de 1936 n’eurent pas de graves répercussions bien que le secrétaire régional de la CGT fût ouvrier tisserand chez nous.
Les relations avec le comité d’établissement de Beauvais furent toujours excellentes. Dans le Nord il n’y eut pas non plus de problème. On n’avait pas attendu la loi sur les comités d’entreprise pour avoir des cantines, des bibliothèques et des terrains de sport La seule nouveauté qu’apporta la loi fut l’obligation pour la Direction de communiquer au Comité d’entreprise le Bilan et le compte d’exploitation. Lors de la première réunion qui était présidée par Mr. L.LA1NÉ Président du conseil d’administration, celui-ci me demanda de l’accompagner pour répondre aux questions éventuelles.
Je fus soumis à un feu nourri de questions toutes plus naïves les unes que les autres, ce qui était normal pour des gens qui n’avaient jamais été informés et qui voyaient un bilan pour la première fois. Le Comité n’avait pas voulu, comme il en avait le droit, demander l’aide d’un expert-comptable. Alors à la fin de la séance, voyant qu’ils n’avaient toujours rien compris, je leur proposais de leur envoyer, la semaine suivante, un commentaire pour leur expliquer ce que signifiaient les chiffres du bilan et d’où venaient les différences d’une année à l’autre. Le résultat a été que j’ai dû refaire ce rapport tous les ans et que chaque année, quand je leur demandais quelles questions ils avaient à me poser : Rien, me répondait-on, faites nous le même rapport l’an prochain.
ANNEXE FOND DOCUMENTAIRE DISPONIBLE AUX ARCHIVES NATIONALES
Ce fonds est entré au Centre des archives du Monde du travail en 2004. Il a été donné par M. Denis Parenteau, fils de M. Jean Parenteau, ancien directeur général adjoint et administrateur de la Manufacture française de tapis et couvertures, employé à la Manufacture entre 1929 et 1969. Le fonds se compose des comptes rendus d’assemblées ordinaires et extraordinaires entre 1920 et 1978, de notes accompagnant les bilans comptables, d’une liste des cadres de la MFTC, d’un historique de la manufacture rédigé par Jean
Parenteau et de cartes postales sur l’entreprise.
Source : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/2004_006/2004_006_FICHE.html
LA MFTC aujourd’hui : (beauvais.fr)
Manufacture française de tapis et couverture (MFTC)
Suivant la tradition « drapante » de Beauvais, cette usine de production textile est créée en 1839 par les frères Tétard et reprise en 1890 par Edmond Lainé. Cet industriel souhaite moderniser l’usine pour en faire une industrie moderne. Elle se développe alors et de nouveaux ateliers de fabrication sont construits en 1895 à proximité de la tour Boileau. En 1919, sous l’impulsion de Lucien Lainé, fils d’Edmond, la société devient la Manufacture française de tapis et de couvertures (MFTC) implantée sur plusieurs sites dans l’Oise mais aussi dans le Nord et en Belgique.
La manufacture est en pleine apogée quand les bombardements de la Seconde Guerre mondiale détruisent 75% de l’usine dont les bâtiments situés au sud-ouest du centre-ville à l’angle de la rue Desgroux et de l’actuel boulevard Aristide-Briand qui n’ont jamais été reconstruits. En 1964, la MFTC fusionne avec Boussac-Saint-Frères, fabricant de sacs de toile, de produits d’emballage et de tapis, qui domine l’industrie textile française. Bien que la manufacture ferme ses portes en 1985, l’usine dite « de l’Avelon » construite en 1921-1922 a été conservée et abrite aujourd’hui le centre commercial Saint-Quentin.


